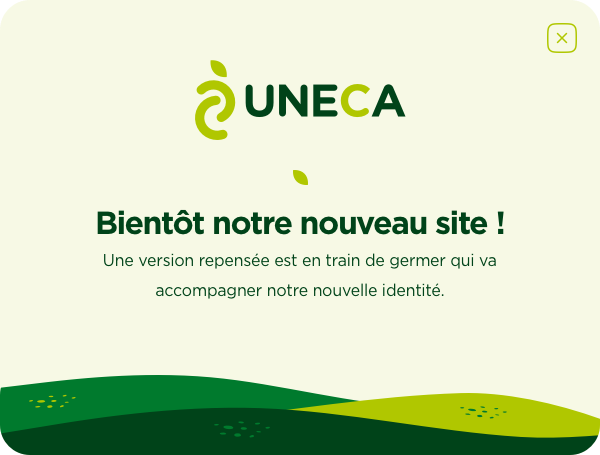Dans quel cas la pulvérisation par drones est autorisée ?

L'usage de drone pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques est permis, de façon dérogatoire et dans des conditions strictes, par le droit européen. Certains pays permettent d'ores et déjà un tel usage. En France, l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime interdit la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques, tout en précisant que “pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé”.
A la suite de l'expérimentation menée dans le cadre de la loi Egalim de 2018, qui a démontré que cet usage présentait, dans certaines conditions, “des résultats prometteurs”, la loi récemment votée propose d'instaurer un cadre strict permettant l'usage de drones sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol. Trois catégories de produits, les moins dangereux, pourront être autorisés dans les programmes d’application par drones : les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique et les produits à faible risque. Il est précisé par le législateur que ces programmes d’épandage doivent présenter “des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre”.
Ces programmes d’application par drones ne seront pas automatiques. Les conditions d’autorisation sont conditionnées à un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Anses et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles.
Enfin, la loi autorise des essais sur d’autres parcelles et cultures. Des programmes d’épandage, avec les trois catégories de produits précités, pourraient être autorisés à titre d’essai, pour une durée maximale de trois ans, “lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre”. Les résultats de ces essais feront l’objet d’une évaluation par l’Anses qui devra être présentée à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le législateur renvoie à un décret le soin de définir les conditions et les modalités de réalisation de ces essais.
Image by Bernd Thomas from Pixabay

 Les formations
Les formations